Saint Loup de Troyes

Bonrepos-Riquet
Rosace de l'église
Lupus, fils d'Épiroque, est né parmi les Leuques dans les environs de Toul, vers 395. Son père nommé Épiroque étant décédé, c'est son oncle Alistique qui le prend en charge. Il effectue alors des études de rhétorique et de latin pour enfin être avocat. Il se marie avec Piméniole, cousine de saint Hilaire d'Arles et parente de Saint Honorat. Après sept ans de mariage, les époux choisissent ensemble de devenir moine et moniale et se séparent.
Moine à Lérins
 Iles de Lérins - l'île Saint Honorat
Iles de Lérins - l'île Saint HonoratL'île, Lerina en romain, est inhabitée et infestée de serpents lorsque Honorat d'Arles accompagné de l'ermite Saint Caprais de Lérins y fonde un monastère. Selon la tradition, Honorat s'installe sur l'île avec l'intention de vivre comme un ermite, mais il est rejoint par des disciples qui constituent une communauté cénobitique autour de lui entre 400 et 410. Ainsi l'île de Lérins devient un « immense monastère » dès 427.
Honorat codifie la vie de la communauté, avec une règle dont la première rédaction, la « Règle des Quatre Pères », est la première du genre en France.
Durant les Ve et VIe siècles, le monastère attire des moines qui assureront sa renommée. Ainsi, Saint Patrick y étudie avant d'entreprendre l'évangélisation de l'Irlande. Saint Loup de Troyes, Saint Jacques de Tarentaise ou Saint Apollinaire viennent également dans cette abbaye. Le moine le plus célèbre est peut-être Vincent de Lérins, frère de Loup, qui rédige à Lérins le Commonitorium.
Autour de 732, cinq cents membres de la communauté sont massacrés par les Sarrazins. L'un des rares survivants, Saint Elenthère rebâtit un nouveau monastère sur les ruines de l'ancien.
Evêque de Troyes
En 426, L'évêque de Troyes Ursus étant récemment décédé, le chapitre de la cathédrale décida spontanément de l'élire comme évêque, contre son gré. Restant cependant fidèle à ses engagements monastiques, il continua sa vie ascétique tout en assumant ses devoirs pastoraux.
En 429, à la demande du Pape Célestin et des Evêques de Gaule réunis en Concile, il accompagna Saint Germain d'Auxerre en Grande-Bretagne, pour y lutter contre les hérétiques pélagiens qui prétendaient se passer de la grâce divine. Les évêques commencent par gagner Paris et rencontrent sainte Geneviève, encore enfant, à Nanterre. Là, saint Germain sent son aura sainte parmi la foule. Il lui remet une pièce de monnaie symbolique et la recommande à Dieu au cours d'une messe. Puis, les deux saints embarquent pour la Bretagne.
Il regagne Troyes avec une autorité accrue du succès éclatant qui a couronnée sa mission créditée de plusieurs miracles.

Puvis de Chavannes. XIXe
Artisans de Paix
En 451, Attila, chef des Huns, effectue une percée en Gaule au retentissement considérable. Il ravage Reims, Cambrai, Auxerre... Le chef romain Aétius finit par l'arrêter lors de la bataille des champs catalauniques, lieu proche de Troyes. En se repliant en direction de la Seine, le chef hun vient à passer par Troyes. La ville n'a aucun moyen de défense face au barbare et à ses troupes : son mur d'enceinte est largement vétuste En 451, Geneviève à Paris et Loup à Troyes protègent héroïquement leur cité contre Attila et son armée. Loup envoie à Attila quelques membres de son clergé en ambassade dont Mémorius et Camélien : c'est un échec, Attila les fait massacrer, sauf un seul, Camélien, qui survit à ses blessures et qui va devenir le successeur de saint Loup comme évêque de Troyes. L'évêque décide alors d'aller lui-même vers Attila et il réussit à le convaincre d'épargner la ville et de se retirer.

« Loup, évêque de Troyes, encouragé par l’exemple de Geneviève et d’Aignan, sort courageusement de sa ville, rencontre Attila et s’entend vite avec lui. Ils décident que Troyes paiera un tribut aux Huns, ne participera pas aux actions militaires contre Attila et donnera des otages en garantie de cet accord. Loup est prêt à devenir lui-même un des otages afin de sauver les citadins, mais l’empereur hun libère le vieil évêque après une conversation amicale. Loup raconte à Attila qu’il connaît bien Geneviève de Paris, qu’il y a plus de vingt ans en route pour les îles Britanniques, il a visité avec Germain, évêque d’Auxerre, ses parents riches dans leur villa à Nanterre. »(Extraits du roman de Grigori TOMSKI, Les amis d’Attila)
Mais la région est ravagée après le passage des Huns et se dépeuple.
Saint Loup encourage et protège alors les premières foires de Champagne.
Loup se retire
Il passe deux années reclus au mont Lansuine à 60 km de Troyes, et deux autres à Mâcon où on le crédite de plusieurs miracles, avant de reprendre possession de son siège épiscopal.
Il meurt à Troyes le 29 juillet 479, au terme d'un épiscopat de 52 ans. Il est inhumé à Saint-Martin-ès-Aires.
En 570, les rois Gontran et Chilpéric, petits fils de Clovis, viennent sur son tombeau pour se jurer une paix réciproque.
Les restes de Saint Loup ont été profanés et dispersés dans la nuit du 9 au 10 janvier 1794, sauf une portion de crâne que conserve la cathédrale de Troyes.
Saint Sidoine Apollinaire, Evêque de Clermont, le loue en ces termes : « Vous êtes le Père des Pères, l'Evêque des Evêques, le Saint Jacques de votre siècle... »
Il est invoqué contre la possession du démon, la paralysie et l’épilepsie.
Sainte Bernadette

| Naissance : | Le 7 janvier 1844 à Lourdes, Hautes-Pyrénées |
| Décès : | Le 16 avril 1879 à 35 ans à Nevers, Nièvre |
| Fête : | Le 18 février |
| Béatification : | Le 14 juin 1925 par Pie XI |
| Canonisation : | Le 8 décembre 1933 par Pie XI |
| Apparitions : | 18 apparitions entre le 11 février et le 16 juillet 1858 |
Depuis le 3 août 1925, le corps de Bernadette¸ découvert intact lors de l’exhumation du corps pour sa béatification, repose à Nevers dans une châsse de verre dans la chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildard. Sur son visage et sur ses mains ont été déposés de très fins masques de cire.
Vie
Bernadette Soubirous, de son vrai nom Marie-Bernade Soubious, naquit au moulin de Boly, au pied du château fort de Lourdes. Elle est la fille aînée de François Soubirous et de Louise Castérot. Bernadette a eu une sœur : Marie, et trois frères : Jean-Marie, Justin qui a vécu dix ans et Bernard-Pierre, son filleul. Quatre autres enfants sont morts en bas âge.
Le moulin de Boly dont François avait la charge depuis son mariage est peu rentable et François se révèle mauvais gestionnaire. En 1854 la famille, ruinée, déménage pour s’installer dans la maison Laborde, un ancien moulin, juste à côté de celui de Boly. François s’embauche alors au jour le jour comme « brasier », c’est-à-dire qu’il loue la force de ses bras pour des travaux manuels. C’est le travail le moins bien payé qui soit. De son côté, Louise fait des ménages et des lessives.
En 1855, à la mort de la grand-mère maternelle de Bernadette, les Soubirous perçoivent un petit héritage de 900 francs, ce qui représente environ deux ans d’un salaire de manœuvre. François loue le moulin de Sarrabeyrouse à Arcizac-ez-Angles à quatre kilomètres de Lourdes. Les Soubirous s’achètent aussi un petit cheptel. Moins d’un an plus tard, non seulement l’héritage est entièrement dépensé, mais le couple s’est endetté. En novembre 1856, ils sont expulsés et s’installent dans la maison Rives, 14 rue du Bourg à Lourdes. En janvier 1857 ne parvenant pas à payer le loyer, le propriétaire les expulse en retenant l’armoire, le dernier meuble de valeur de la famille. Un cousin de Claire met alors à leur disposition le rez-de-chaussée d’un immeuble dont il est propriétaire à Lourdes. Cette pièce est appelée « le cachot », car elle a servi un moment pour la détention de prisonniers en attente de jugement au tribunal situé juste à côté. Les Soubirous logent à six dans ce « bouge infect et sombre » de 3,72 × 4,40 m2. Louise demande alors à sa sœur, Bernade, d’accueillir Bernadette chez elle. Bernadette passera ainsi l’hiver chez sa marraine qui tient un cabaret. Elle y fait le service et le ménage et ne va toujours pas à l’école ni au catéchisme.
En septembre 1857, Bernadette est envoyée chez son ancienne nourrice, Marie Laguë, à Bartrès. Elle y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d'eau et de bois, garde les agneaux et commence à préparer sa première communion. Obligée de revenir à Lourdes pour continuer le catéchisme, elle est admise, fin janvier 1858, quelques jours avant les apparitions, comme externe dans la classe des indigents de l’Hospice de Lourdes, tenue par les sœurs de la Charité de Nevers. C'est là qu'elle commence, mais de façon irrégulière à s'instruire et à s'initier au métier de couturière.
En février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher de Massabielle. Elle témoignera de dix-huit apparitions mariales entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Concernant les apparitions, Bernadette employait surtout le terme occitan « aquerò », c'est-à-dire « cela », pour désigner l’objet de sa vision. Elle ne dira pas elle-même avoir vu la Vierge avant de l’avoir entendu dire « Que sòi era Immaculada Concepcion », c'est-à-dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Au cours d’une de ces apparitions, Bernadette a creusé le sol pour y prendre de l’eau. L’eau de cette source est rapidement réputée miraculeuse et il commence à être question de guérisons.
Quelques années après les apparitions de la Vierge à Catherine Labouré dans la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, située rue du Bac dans le7earrondissement de Paris, et à deux enfants le 19 septembre 1846 à La Salette-Fallavaux, près de Corps (Isère), la presse nationale commence à s'y intéresser, durant l'été 1858, notamment avec la publication, par Louis Veuillot, d'un article très remarqué dans L’Univers. Le préfet de Tarbes, suivant les consignes du ministère des cultes, maintient une interdiction d'accès à la grotte jusqu'en octobre 1858, tandis qu'une commission d’enquête, mise en place par l'évêque de Tarbes, en juillet 1858, se prononce en faveur de ces apparitions en 1862. L’aménagement de la grotte et la construction d’une basilique sur le rocher qui la surplombe commencent alors.
Peu après, début 1859, l'abbé Peyramale s'étant porté caution, François Soubirous peut louer le moulin Gras et reprendre son métier de meunier. Durant cette période, Bernadette travaille comme garde d'enfants, elle tente de combler son retard scolaire avec l'aide d'Augustine Tardhivail qui l'enseigne bénévolement, et elle joue son rôle d'aînée à la maison dans les tâches ménagères et vis-à-vis de ses frères et de sa sœur. Enfin, elle répond aux innombrables questions sur les apparitions, rencontrant des visiteurs même lorsqu'elle est malade et alitée.
Au printemps 1860, ne pouvant plus contenir le nombre de personnes qui veulent la rencontrer, Bernadette entre en pension à l'hospice des sœurs de la Charité d’où elle ne peut sortir qu’accompagnée. Bien que son retard scolaire soit important, elle fait des progrès rapides en lecture et en écriture, apprenant ainsi le français. Elle est douée pour la couture et la broderie. Du point de vue des sœurs, sa piété est irréprochable bien qu'elle ne fasse pas preuve d'un zèle particulier à cet égard.
En l'espace de quelques mois, Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, était devenue une célébrité internationale, tandis que la vie dans cette bourgade des Pyrénées commençait à être transformée par l'affluence de pèlerins, de curieux et de journalistes. Entre 1858 et 1866, Bernadette continue de vivre à Lourdes, où sa situation devient, cependant, de moins en moins tenable. Sans cesse sollicitée, tout en refusant de percevoir quoi que ce soit en rapport aux apparitions ou à sa célébrité, elle se pose la question d’une vie religieuse.
Le 4 juillet 1866 Bernadette quitte les Pyrénées, qu'elle ne reverra jamais pour Nevers (voir "vie religieuse). Elle meurt à l'infirmerie Sainte-Croix le 16 avril 1879, à 15 h 30, à l'âge de 35 ans.
Vie religieuse
Depuis 1858 elle côtoie les soeurs de la Charité de Nevers qui gèrent l'Hospice de Lourdes où elle est scolarisée.
Le 4 avril 1864, suivant la recommandation de l’évêque de Nevers, Bernadette annonce à la mère Alexandrine Roques, supérieure de l'hospice de Lourdes, qu’elle est décidée à entrer chez les sœurs de la Charité. Deux ans plus tard, alors que la construction de la basilique est en cours, Bernadette a 22 ans et quitte Lourdes, qu'elle ne reverra jamais, pour entrer au couvent Saint-Gildard, à Nevers. Elle y mène treize années d'une vie de « religieuse ordinaire », ayant néanmoins la particularité de recevoir la visite de nombre d’évêques, parmi ceux qui souhaitent se faire une opinion sur elle et sur les apparitions Le 29 juillet, elle prend l'habit de novice et reçoit le nom de sœur Marie Bernard. Le 30 octobre 1867, Bernadette a fait sa profession religieuse. D'octobre 1867 à juin 1873 elle est aide-infirmière, puis responsable de l'infirmerie. En 1873, malade en permanence, elle redevient simplement aide-infirmière. L'année suivante, elle se partage entre les fonctions d'aide-infirmière et d'aide-sacristine. À partir de 1875, elle est constamment malade. Elle est atteinte de tuberculose et souffre de son asthme chronique. Elle prononce ses vœux perpétuels le 22 septembre 1878.
Miracles
Sur quelque 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 69 cas ont à ce jour été reconnus miraculeux par l'Eglise :
- Plus de 80% des miraculés sont de sexe féminin,
- Le plus jeune miraculé avait 2 ans,
- 55 miraculés sont français, 8 italiens, 3 belges, 1 allemand, 1 autrichien et 1 suisse,
- La première miraculée est Catherine LATAPIE (France) en mars 1852, reconnue le 18 janvier 1962.
- La dernière miraculée à ce jour est Danila CASTELLI (Italie) en mai 1989, reconnue le 20 mars 2013.
Béatification
L'instruction de la cause de béatification de Bernadette, décédée à Nevers le 16 avril 1879, va nécessiter l’exhumation du corps. Cela se fait en trois temps : septembre 1909, avril 1919 et avril 1925. A la grande surprise des observateurs, le corps de Bernadette est découvert intact. Un véritable mystère qui n'est cependant pas unique au monde. La science et la médecine n'émettent que des hypothèses.
Saint Joseph

| Vénéré par : | Toutes les Églises chrétiennes qui admettent le culte des saints. |
| Fête : | Reconnu comme "saint" par l'ensemble de la tradition chrétienne, il est liturgiquement fêté le 19 mars, ou localement le 1er mai, en tant que saint patron des travailleurs manuels. |
| Attributs : | Équerre, bâton fleuri, gourde, lys. |
| Saint Patron : | De l'Église Universelle (proclamé par le pape Pie IX en 1870), des charpentiers, des travailleurs, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Autriche (ainsi que des Land suivants : Vorarlberg, Tyrol, Carinthie et Styrie), de la Belgique, de la Croatie, du Canada, des États-Unis, du Mexique, du Pérou, de la Chine, de la Corée du Sud, du Vietnam, du Canton de Nidwald (Suisse), de la ville de Turin, du troisième millénaire et de la nouvelle évangélisation. |
Histoire biblique
Saint Joseph, est un lointain descendant d'Abraham et du roi David (Mt 1,1-17). Il est fiancé à Marie lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Dès lors, il épouse Marie et, acceptant l'enfant, il devient le père nourricier de Jésus qui, de ce fait, appartient à sa lignée, celle de David. Il est présenté comme un « homme juste » qui a accepté d'accueillir Marie et son enfant à la suite du message de l'archange Gabriel.
Il est indiqué en Mt 13,55 qu'il est «charpentier», sans que l'on sache s'il faut prendre ce terme au sens premier ou avec celui «d'homme sage». Joseph est mentionné pour la dernière fois lors du pèlerinage familial à Jérusalem lorsque Jésus, âgé de douze ans, est retrouvé au Temple (Lc 2,41-50). La tradition chrétienne en a déduit qu'il était mort avant que Jésus n'entre dans la vie publique.
Joseph n’est cité que dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Chacun des deux contient une généalogie de Jésus qui fait remonter ses origines au Roi David, mais les deux partent de fils de David différents. Matthieu (Mt 1,1-16) suit la lignée royale ainée de Salomon, tandis que Luc (Lc 3,23-38) suit une ligne cadette, celle de Nathan, un autre fils de David et de Bethsabée.
Ils diffèrent aussi dans les récits de l'enfance de Jésus. Dans Luc, c'est à Nazareth que vit Joseph et il se rend à Bethléem pour obéir aux exigences d'un recensement ordonné par Rome. C'est pourquoi Jésus y est né. Dans Matthieu, Joseph résidait à ce moment à Bethléem, et ensuite il s'est installé à Nazareth avec sa famille après la mort d'Hérode. Matthieu est le seul Évangile qui nous conte le récit du Massacre des Innocents et la Fuite en Égypte (Mt 2,13-16) : après la nativité, Joseph reste à Bethléem pendant une durée indéterminée (peut-être deux ans) avant d'être forcé par Hérode de se réfugier en Égypte. A la mort de celui-ci, il retourne avec sa famille en Judée, puis s'installe à Nazareth.
Tradition Culte
La tradition chrétienne représente Marie comme étant veuve pendant le ministère de son fils devenu adulte. Les évangiles décrivent Joseph comme un «tekton», interprété par l’Eglise dans le sens de «charpentier» bien que le terme grec évoque un artisan travaillant le bois en général (charpente, meubles, outils), ou un artisan travaillant le fer ou la pierre, c'est-à-dire qu'il pouvait participer à la construction de toutes sortes d'édifices. Saint Joseph figure dans l’histoire de la Bible et de l’Église comme « le grand silencieux ». S’il nous est possible d’accéder à l’âme de la Vierge Marie à travers ses quelques phrases retenues dans les évangiles, il n’en va pas de même pour son époux, Joseph. Pas une seule phrase de lui n’a été rapportée par les évangélistes.
Pourtant, ce silence non seulement ne nuit pas à sa sainteté mais il accorde une grande profondeur à sa mission. Joseph a reçu l’annonce de l’ange en songe. Il s’est levé pour accomplir la mission demandée par Dieu : prendre Marie pour épouse et veiller sur l’enfant Jésus qui va naître, non pas du vouloir de l’homme mais de l’Esprit Saint.
C’est pourquoi saint Matthieu l’évangéliste l’appelle « juste ». Pour nous, le mot justice nous fait penser à la justice sociale et aux revendications salariales. Dans la Bible, la justice équivaut à la sainteté. Joseph est juste, non seulement parce qu’il a travaillé correctement dans son atelier d’artisan dans le bâtiment mais parce qu’il a ajusté sa volonté à celle de Dieu. La prière du Notre Père a pris chair en lui : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».
Le culte de Saint Joseph est marginal jusqu’ au XIIIe siècle où il commence à sortir de l’ombre pour prendre de l'ampleur au XVIe siècle.
Apparitions
Trois apparitions de Saint Joseph sont citées à ce jour :
- à Cotignac, le 7 juin 1660, à Gaspard Ricard, un berger, apparition au cours de laquelle il aurait fait jaillir une source qui coule toujours,
- A Knock en Irlande, le 21 août 1879, 15 personnes (de tous âges) ont vu, sur le pignon sud de l'église communale de Knock, la Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Jean l'évangéliste ainsi que Jésus,
- A Fátima au Portugal, le 13 octobre 1917, aux voyants de Fátima, tenant l'Enfant Jésus dans ses bras.
Saint Jean-Marie VIANNEY, le Curé d'Ars

| Naissance : | le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon |
| Décès : | le 4 août 1859 à Ars |
| Fête : | le 4 août |
| Béatification : | en 1904 à Rome par Pie X |
| Canonisation : | en 1925 à Rome par Pie XI |
| Saint patron : | de tous les Curés de l'Univers ou saint directeur de tous les prêtres. |
| Il fut déclaré en 1905 « patron des prêtres de France » par le pape Pie X, puis « patron de tous les curés de l’univers » en 1920 par le pape Pie XI. Le pape Benoit XVI a déclaré l’Année sacerdotale 2009-2010 sous le patronage du Saint curé d’Ars. | |
Vie
Il est le quatrième de six enfants d’une famille de cultivateurs. Ses parents, surtout sa mère, sont des chrétiens pieux, qui offrent couramment le gîte et le couvert aux plus nécessiteux. Les Vianney souffrent de la tourmente révolutionnaire. Jean-Marie est contraint de suivre le catéchisme et de faire sa première communion clandestinement. À 17 ans, il confie à son père son désir d'être prêtre: pour «gagner des âmes au Bon Dieu». Mais ce dernier s'y oppose et exige qu'il reste travailler auprès de lui. Il a 20 ans quand son père cède. En 1806 il entre au séminaire dirigé par le curé d’Écully, M. Balley. C’était un élève médiocre, surtout parce qu'il avait commencé à étudier très tard. Il n'entendait rien à la philosophie du fait qu'elle s'enseignait en latin, mais son évêque qui connaissait sa piété finit par l’ordonner prêtre en 1815.
Il fut alors envoyé à Ecully comme vicaire de M. Balley, puis après la mort de celui-ci en 1818 il fut nommé curé d’ Ars-sur-Formans, dans le département de l'Ain, qui comptait environ 200 habitants à l'époque. Après quarante et un ans de service, il meurt épuisé à 73 ans.
« Laissez vingt ans une paroisse sans prêtre, on y adorera les bêtes » avait-il constaté. Sa piété, ses sermons et son zèle de pasteur ramenèrent peu à peu la ferveur religieuse dans sa paroisse. Homme de prières, il dormait très peu, il se levait tous les matins très tôt pour aller prier dans l'église glacée. Il passait des journées entières à confesser, convaincu que son pari de ramener ses paroissiens vers Dieu pouvait être gagné à condition de faire confiance à la miséricorde divine.Il redistribuait tout ce qu'on lui donnait et n'hésitait pas à se démunir encore pour subvenir aux besoins de plus pauvre que lui. Il rendait ses paroissiens responsables du bien commun en leur demandant de réaménager le cimetière, d'entretenir l'église, d'organiser des fêtes qui ne fussent plus des lieux de perdition. Il était convaincu que l'éducation et l'enseignement catéchistiques stimuleraient les âmes pour les conduire vers la sainteté.
En 1824, il ouvrit une école de filles dite « Maison de la Providence ». Il fit de Catherine Lassagne, humble femme et sa fidèle servante, responsable de son école après l'avoir catéchisée. Il l'appelait « la plus belle fleur de mon jardin » car il avait perçu chez elle le don de comprendre l'amour de Dieu.
Dévouement et dévotion
Dès 1830 commença l'afflux des pèlerins à Ars. En 1849, il fonda l'école des garçons, confiée aux Frères de la Sainte Famille de Belley.
Le saint curé d'Ars était déjà considéré comme un saint de son vivant tant il était dévoué à l'œuvre de Dieu. Il disposait de grâces étonnantes notamment comme confesseur. Sa charité était par ailleurs sans limite : il mangeait peu, passait des heures entières en adoration du Saint-Sacrement; il dormait peu, surtout à la fin de sa vie, passant jusqu'à seize heures par jour à confesser.
Jean-Marie Vianney était plein de bon sens, savait faire preuve d'humour. On aura retenu de lui quelques phrases célèbres :
- Quand son lit prit feu, une nuit : "Le démon n'a pas pu brûler l'oiseau, il n'a brûlé que la cage".
- Un jour une personne corpulente lui dit : "Quand vous irez au Ciel, je tâcherai de m'accrocher à votre soutane", et le Curé d'Ars, qui n'avait que la peau sur les os à force de toujours tout donner et de refuser la nourriture un peu reconstituante que ses paroissiennes essayaient de lui prodiguer, de répondre :"Gardez-vous-en bien ! L'entrée du Ciel est étroite, et nous resterions tous deux à la porte".
Il reçut la visite de Lacordaire: " La plus célèbre visite qu'ait reçue le curé d'Ars est sans doute celle du père Lacordaire. Venant à Lyon en simple pèlerin, l'illustre dominicain arrive incognito dans une modeste voiture. Or, sous les plis de son manteau noir, quelqu'un aperçoit une robe blanche, et très vite les pèlerins d'Ars apprennent qui est le visiteur. Remous profond. Le lendemain, on voit le père Lacordaire écouter dans un humble recueillement le sermon du curé(...) Il ne le quitte qu'avec déchirement et va même, s'agenouillant devant lui, jusqu'à lui demander sa bénédiction. Après quoi, J.M.Vianney le prie de le bénir à son tour : et c'est bien une scène étrange et pathétique, éclairée d'un jour du Moyen-Âge, digne de saint François d'Assise et de saint Dominique". Michel de Saint-Pierre, La vie prodigieuse du curé d'Ars.
Un de ses amis, Claude Laporte, lui fit un jour don d'une montre, que le Curé d'Ars s'empressa de donner à plus pauvre que lui. Claude Laporte renouvela l'opération trois ou quatre fois. Mais le Curé d'Ars la donnait toujours, ou vendait la montre pour en donner l'argent aux pauvres. Ce que voyant, Claude Laporte lui dit un jour en lui mettant une nouvelle montre entre les mains "Monsieur le Curé, je vous prête la montre que voici." C'était une belle montre. Le Curé d'Ars la conserva toute sa vie; à sa mort elle fut restituée à la famille Laporte.
Sainte Germaine

| Naissance : | 1579 à Pibrac près de Toulouse, Haute-Garonne |
| Décès : | 1601 à Pibrac |
| Fête : | 15 juin |
| Béatification : | 7 mai 1854 par Pie IX |
| Canonisation : | 29 juin 1867 par Pie IX |
| Sainte patronne : | Des faibles, des malades, des déshérités, ainsi que des bergers. |
Vie
Sainte Germaine de Pibrac, de son vrai nom "Germaine Cousin", est la fille d'un modeste laboureur, Laurent, époux de Marie Laroche.
Atteinte de scrofules (adénopathie tuberculeuse), elle a aussi une main atrophiée. Sa mère meurt alors qu'elle était encore très jeune, et dès lors, elle subira les humiliations de sa belle-mère, acariâtre, et sera reléguée dans un appentis, loin de la vie familiale.
Elle persuada son père de l'envoyer garder les troupeaux, où là, dans la nature, elle pouvait réciter son chapelet et trouver le réconfort dans la prière. Tous les jours elle allait à la Messe. Elle plantait sa quenouille en terre et la quenouille gardait les moutons ; jamais une brebis ne s'égara, et jamais non plus les loups, pourtant nombreux dans la région à cette époque, n'attaquèrent le troupeau.
Elle donnait le peu de pain qu'elle avait aux pauvres. Un jour de1601, son père la trouva morte dans le réduit où on l'obligeait à dormir. Elle avait 22 ans. Elle fut enterrée dans l'église de Pibrac, et peu à peu tout le monde oublia l'existence de cette sépulture.
A Pibrac, une basilique de style romano-byzantin a été élevée en son honneur. Construite par l'architecte Pierre Esquié de 1901, année où on y posa la première pierre le 15 juin sur l'emplacement d'une ancienne chapelle, elle ne fut achevée qu’en 1967. La maison natale de Germaine Cousin existe toujours. Elle est située à environ 2 kilomètres du village de Pibrac. Récemment restaurée, on peut la visiter.
Les miracles de son vivant
Pour aller à l’église, elle devait passer un gros ruisseau. Un jour que le ruisseau était en crue, des paysans qui la voyaient venir se demandaient, d’un ton railleur, comment elle ferait pour passer. Les eaux s’ouvrirent devant elle et elle traversa sans même mouiller sa robe.
Un jour, sa marâtre l'accusa de voler du pain. Elle la poursuivit afin de la frapper et de la confondre, malgré l’insistance de voisins qui voulaient la retenir. Quand celle-ci rattrapa Germaine et lui fit ouvrir son tablier, à la place du pain qu'elle pensait y trouver s'étalait une brassée de roses. Son père fut alors ébranlé, il interdit à sa femme de frapper Germaine et lui demanda de réintégrer la maison ailleurs que dans le grabat qu'elle occupait. Elle refusa. La nuit de sa mort, on raconte que deux religieux en route pour Pibrac à la nuit tombée, virent passer en direction de la maison de Laurent Cousin deux jeunes filles vêtues de blanc. Le lendemain matin, alors qu'ils reprenaient leur route, ils virent ressortir trois jeunes filles, dont l'une, encadrée par les deux autres, était couronnée de fleurs.
Les miracles après sa mort
En 1644, alors que le sacristain se préparait à organiser des funérailles en creusant une fosse, il tomba sur un corps enseveli dont la fraîcheur le stupéfia. Même les fleurs que la morte tenait étaient à peine fanées. A la difformité de sa main, aux cicatrices des ganglions de son cou, on reconnut Germaine Cousin. Son corps fut déposé dans un cercueil de plomb, offert par une paroissienne guérie par l'intercession de la sainte, et déposé dans la sacristie où il demeura, à nouveau oublié, encore 16 ans.
Le 22 septembre 1661, le vicaire général de l’archevêque de Toulouse, Jean Dufour, vint à Pibrac. Il s'étonna de voir ce cercueil resté dans la sacristie, le fit ouvrir, et découvrit que la sainte présentait toujours le même état de fraîcheur. Il fit creuser tout autour de là où le corps avait été trouvé, et tous les morts enterrés au même endroit n'étaient plus que des squelettes. Ebranlé par ce miracle, le vicaire général demanda la canonisation de Germaine en 1700. Sa dépouille subit encore de nombreuses pérégrinations accompagnées de plusieurs miracles.
Sous-catégories
Page 3 sur 18




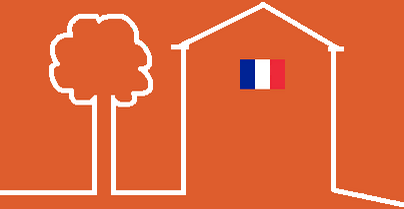
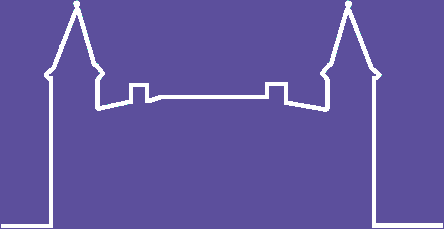

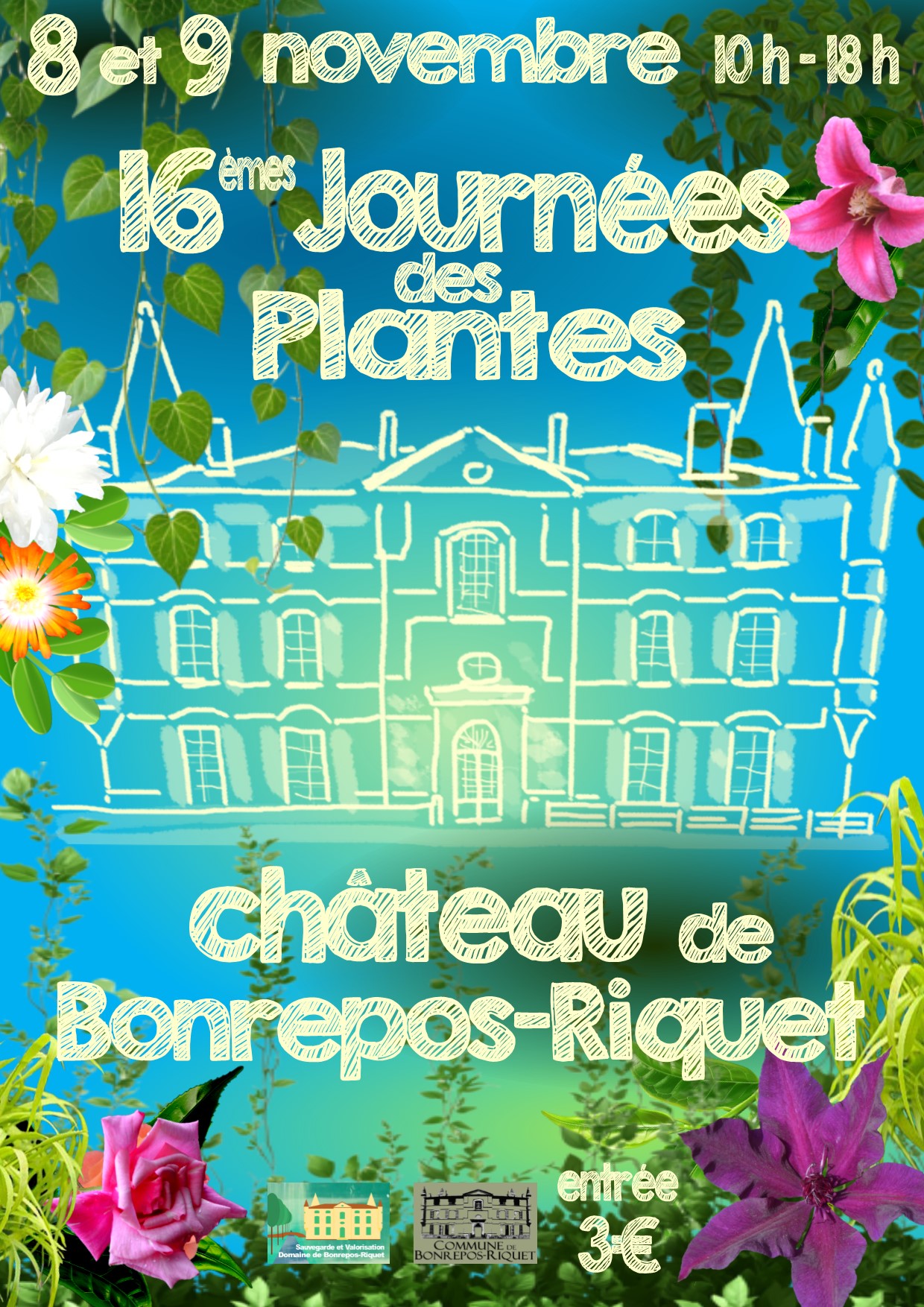

 Louer l'orangerie du château
Louer l'orangerie du château